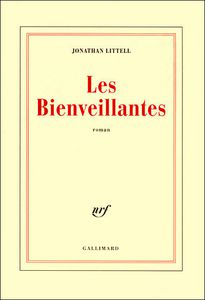Littérature > Goncourt 2009 > Trois femmes puissantes, de Marie NDiaye
*StarCactus* : Tapis rouge

Cette année marque une nouvelle résolution dans le calendrier de mes lectures. Les têtes de gondoles aidant, j’ai décidé de lire chaque année le livre ayant décroché le célèbre prix Goncourt. En effet, il me tient à cœur, malgré le choix infini de mes classiques chéris, de m’intéresser un peu plus à la littérature contemporaine. Quel autre ouvrage que celui désigné par un tel prix serait plus adapté à une telle contemplation ? A noter que je ne me fais nulle illusion quant au choix du jury : sans véritable compétition littéraire, le Goncourt est avant tout une opération marketing ficelée d’un ruban de soie. Mais il constitue néanmoins une forme d’exemple de ce qu’on attend ou considère comme la grande littérature de nos jours. C’est d’autant plus amer pour moi que d’en inaugurer sur ce blog ma première critique négative…
Trois femmes puissantes est un titre qui nous promet du plaisir. Il évoque, sur tracé contemporain d’un féminisme affaibli et branché - il n’a jamais été de meilleur ton de rendre hommage à nos chères compagnes - une aventure audacieuse, auréolée de réussite, des femmes qui tracent leur vie loin de l’influence masculine. Un peu comme Sex & The City, en somme, mais plus intellectuel. On salive, on ACHETE.
Le roman de Marie NDiaye se découpe en trois mouvements principaux : l’histoire de Norah, l’histoire de Fanta (à travers le regard de son mari, Rudy), et l’histoire de Khady Demba. Terminer l’ouvrage vous révèlera les liens ténus mais néanmoins lourds qui lient ces trois femmes. Elles ne se connaissent pas, mais font partie d’un réseau qui, en arrière-plan, n’apporte finalement pas grand-chose. Dommage : n’y avait-il pas là potentiel d’une rencontre, d’un seul mot, d’un geste qui, tendant vers un centre, les rendrait plus proches ?
L’écriture de Marie NDiaye est un défi en soi, mais pas un défi dont on sort grandi ou fier. Difficile à aborder, elle déborde d’adjectifs, de tournures lourdes, de phrases encombrées de plusieurs relatives mal détachées de la principale, autant à la vue qu’à l’oreille. C’est pesant. Elles matérialisent peut-être une certaine atmosphère, oui, qu’il s’agisse du parfum de frangipanier (Norah), de l’écrasante chaleur (Rudy), ou de l’indifférence méchante (Khady Demba). Mais non : les autres livres de Marie Ndaye sont également remplis de cette lourdeur. Comptez une bonne cinquantaine de pages avant de vous y adapter.
Les histoires sont…sont…ben…ca va quoi. C’est pas exceptionnel, en fait. Soit, ce n’est pas si grave : après tout la littérature se nourrit du banal. On notera même quelques frémissements syntaxiques qui nous permettent, à nous, humbles lecteurs lambda, d’apprécier l’envergure intellectuelle de l’écrivaine. Mais l’air de rien, je n’ai pas du tout été emporté. Même s’il s’agit de récits de bassesse, pour ainsi dire, où les personnages affrontent les démons de leur vie, ils manquent du plus élémentaire dynamisme. Tout reste plat, nous laisse dubitatif. Nul génie romantique. Quelques minutes s’étirent sur cinquante pages, à la recherche des tréfonds du fantôme d’une émotion passée. Ok, ça, c’est fait.
Je ne vais même pas vous parler des "histoires" en particulier, ni faire un résumé. Quand j’y pense, peut-être ai-je été trop obtus, malgré mon enthousiasme initial, pour y trouver l’étincelle artistique. Pour moi, elles sont assez pompeuses, sous un voile artificiel de confidences au lecteur, de changements dans la mentalité des personnages… Ca n’a vraiment rien d’extraordinaire. Parfois, l’écriture se clarifie, le temps d’une phrase qui résonne admirablement, à l’image d’un clair de lune scintillant brièvement derrière des nuages qui volent.
Je regrette de dire que j’ai fermé ce livre avec soulagement. Je n’y suis pas entré, je n’ai pas été emporté, ni transformé. A peine y ai-je accordé quelques heures de réflexion, après coup, pour essayer comme à mon habitude de lier les divers éléments qui s’y trouvent. Une écriture lourde et pesante, voilà le goût amer que je retiens de ce Goncourt. Pour cette première occasion décidée, pour la première fois où je m’intéresse à ce prix pour ce qu’il est, je ne peux m’empêcher de repenser aux Bienveillantes, de Jonathan Littell, que j’avais abandonné au bout de cent cinquante pages. Prix Goncourt 2006, j’y trouvais la même platitude, la même langueur, la même absence de cet enthousiasme un peu fantastique qui nous fait aimer la lecture de récits touchants. La littérature française contemporaine se définit-elle donc comme ça ? Inutile complexité ? Intrigue plate ? Sommes nous obligés de répondre, jusque dans nos Lettres, à la réputation de coqs gargarisants ?